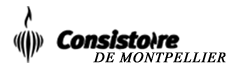Encore 2 femmes à l’honneur cette semaine.

La première s’appelle Louise Glück. Peu de gens la connaissaient. On vient pourtant de lui attribuer le Prix Nobel de Littérature 2020, « pour sa voix poétique caractéristique, qui avec sa beauté austère, rend l’existence individuelle universelle ». Née à New York dans une famille juive hongroise, elle rejoint ainsi la longue liste d’auteurs d’origine juive consacrés par le jury suédois (Bergson, Agnon, Nelly Sachs, Singer, Bellow, Canetti, Kertesz, Modiano et encore tout récemment Bob Dylan…).

La seconde vient de mourir. Elle s’appelait Ruth Klüger et avait écrit un livre capital : « Refus de témoigner », récit hybride sur les camps de la mort et la mémoire, dont je recommande vivement la lecture.

Née le 30 octobre 1931, à Vienne (Autriche), sept ans avant l’Anschluss, au sein d’une famille juive de la moyenne bourgeoisie – son père était gynécologue et pédiatre – Ruth Klüger a 11 ans lorsqu’elle est arrêtée avec sa mère et déportée à Theresienstadt, puis à Auschwitz-Birkenau et Christianstadt ; tandis que son père, qui avait fui à Paris, est arrêté et déporté à Auschwitz, où il sera envoyé à la chambre à gaz. Peu avant la libération des camps, en 1945, lors d’une « marche vers la mort », elle parvient à s’enfuir avec sa mère et gagne la Bavière. Elle y demeure jusqu’en 1947 avant de gagner les Etats-Unis, où elle suivra des études de lettres à l’université de New York et à l’université de Berkeley, en Californie.
En 2016. JOHN MACDOUGALL / AFP
Refusant l’apitoiement, la compassion et surtout l’idée d’être enfermée dans la catégorie des rescapées de la Shoah, Ruth Klüger écrivait dans Refus de témoigner (Editions Viviane Hamy, 1997) : « Je ne viens pas d’Auschwitz, je suis originaire de Vienne (…) Vienne fait partie intégrante des structures de mon cerveau alors qu’Auschwitz a été le lieu le plus aberrant où j’ai pu me trouver, et son souvenir demeure un corps étranger dans mon âme. » Sans doute est-ce là l’une des raisons qui lui fera attendre les années 1990 pour composer ce récit complexe, mêlant autobiographie et réflexion, que certains ont comparé à Si c’est un homme, de Primo Levi. Elle y porte un regard critique sur le travail de mémoire. « La torture n’abandonne pas le torturé, jamais, de toute sa vie », écrivait-elle. A la presse autrichienne Ruth Klüger avait confié son « ressentiment pour une injustice qui ne pourra jamais être réparée ». « Ce n’est pas à nous, survivants, d’être responsables du pardon », disait-elle.
Tendu par une écriture âpre, concise, où affleurent la colère, le sarcasme, la révolte, l’ironie grinçante, ce récit évoque les souvenirs d’une femme de culture doublée d’une infatigable féministe, et se livre à une réflexion stimulante sur le travail de la mémoire. Réflexion qu’elle prolongera, lors de la réédition en poche, par le texte « La mémoire dévoyée : kitsch et camps » qui éclaire sur ses prises de position en matière d’art. « Toute expérience humaine, dit-elle, devrait être transformable en expression artistique. Refuser de traiter la Shoah sous la forme d’une fiction ou d’une œuvre, c’est la mettre dans un ghetto et, une fois encore, refuser aux victimes de s’exprimer. Chaque œuvre doit être jugée pour ce qu’elle est, et seulement pour cela. »
La sienne, salutaire et humaniste, sera couronnée par de nombreux prix dont le prix Mémoire de la Shoah (1998), le Prix Thomas-Mann (1999) et le prix Theodor-Kramer (2011), qui récompense des écrivains en résistance ou en exil.
Tout au long de sa vie, elle aura trouvé refuge dans la poésie – notamment celle de Schiller (1759-1805) – et plus largement la littérature allemande, qu’elle enseigna notamment à Princeton, aux États-Unis, où elle vécut jusqu’à sa mort, le 7 octobre 2020, à l’âge de 88 ans.