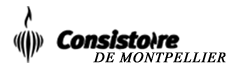Rabbi Jacob
L’HISTOIRE
Trois histoires (un rabbin new-yorkais se rend en France pour une Bar-mitsvah ; un industriel normand se rend au mariage de sa fille ; le leader de l’opposition politique dans un pays arabe est confronté à de violents activistes), a priori indépendantes, vont pourtant se rejoindre et déboucher sur des aventures pour le moins rocambolesques.


ANALYSE ET CRITIQUE
Les Aventures de Rabbi Jacob est un film qui invite à la paresse critique.
D’une part, au moment d’écrire à son sujet, on se dit que tout le monde ou presque connaît le film, et que le commenter reviendrait à dresser le catalogue rituel de ses scènes « cultes », pour certaines tellement inscrites dans le patrimoine du cinéma populaire français qu’elles font l’objet de cérémoniaux collectifs. En quelque sorte, il n’y aurait à dire sur le film que ce que tout le monde en dit : lancez une discussion, lors d’un repas dominical en famille, sur Rabbi Jacob et – s’il se trouvera probablement un oncle un peu pisse-froid pour être celui qui trouve que « De Funès, il en fait quand même des tonnes » – soyez garantis qu’entre deux citations approximatives ou incomplètes (mettons une pièce sur « Salomon, vous êtes juif ? » – en l’occurrence, de notre point de vue, c’est surtout la suite du dialogue qui est drôle ), vous aurez droit au fameux : « Ah, ça, c’est le genre de film qu’on ne pourrait plus faire aujourd’hui » – affirmation au demeurant défendable, mais qui sous-tend parfois un passéisme un peu romancé.


D’autre part, les comédies populaires de Gérard Oury mettant en scène Louis de Funès occupent une sorte de no man’s land analytique, en ce qu’elles furent immédiatement accueillies par le grand public en même temps qu’elles étaient méprisées (parfois avec un dédain violent) par la critique, qui avait des chats plus sérieux à fouetter. Aujourd’hui encore, on a parfois l’impression qu’il n’y a rien d’intéressant ou de nouveau à écrire sur ces films, dans la mesure où les amateurs du film ne chercheraient pas des raisons détaillées pour leur dilection (combien de dossiers, dans la presse généraliste, qui se contentent de rappeler les mêmes anecdotes tout en vantant inconditionnellement le génie de De Funès ?), et où ceux qui ont une appétence pour le travail critique n’en auraient cure : quand l’institution, en l’occurrence la vénérable Cinémathèque de Paris, annonce une rétrospective De Funès au printemps 2020, les boucliers des gardiens du temple se lèvent pour assurer qu’il n’a rien à y faire… Voici donc un texte qui pourrait ne s’adresser à personne – et c’est peut-être encore le meilleur moyen de ne pas décevoir.


Pourtant, Les Aventures de Rabbi Jacob nous semble pouvoir être abordé comme un vrai film d’auteur, en ce qu’il révèle quelque chose du parcours mais aussi des obsessions thématiques ou stylistiques de Gérard Oury – et il serait dommage (pour ne pas dire méprisant) d’évacuer l’idée du revers de la main sous le seul prétexte que le cinéaste a, en effet, réalisé de grandes comédies populaires puis un certain nombre de films assez médiocres. Il ne s’agit pas ici d’exagérer l’importance du style Oury, mais déjà de le reconnaître, et d’en observer les manifestations, en particulier dans un film à ce point personnel.
Pour resituer un peu les choses, Gérard Oury est né Max-Gérard Houry Tannenbaum en 1919, ce qui fait qu’il a à peine plus de vingt ans lorsque, pensionnaire de la Comédie Française, il fuit la France occupée pour échapper aux lois antisémites. Ses débuts dans le théâtre puis dans le cinéma se font dans un registre classique et/ou dramatique, et ses premières réalisations (La Main chaude puis La Menace) n’attirent que peu d’attention. C’est en 1962, sur le tournage de Le Crime ne paie pas, film à sketchs, que Louis de Funès lui assure qu’il est « un auteur comique » et qu’il ne pourra « s’exprimer vraiment que lorsqu’il aura admis cette vérité-là. » La suite est plus connue : en 1963, Oury a l’intuition fulgurante de réunir Bourvil et De Funès pour Le Corniaud, puis c’est La Grande vadrouille en 1966, Le Cerveau en 1969 et La Folie des grandeurs en 1971…


Il a été reproché à Gérard Oury, au moment de La Grande vadrouille, d’occulter la question juive, c’est-à-dire de réduire son approche du contexte de guerre à un support naïf pour des aventures extravagantes et burlesques. Il y avait probablement – outre un air gaulliste du temps qui incitait davantage à l’apaisement silencieux qu’à un réalisme critique – une forme de pudeur, voire d’impréparation, chez l’auteur, à aborder ces questions-là. Lorsque enfin il se met à envisager de réaliser une comédie sur cette communauté hassidique qu’il croise Rue des Rosiers et qui l’intrigue tant, le contexte social a évolué : la deuxième moitié des années 60 et le début des années 70 ont vu successivement naître l’OLP, survenir la Guerre des Six Jours ou Septembre Noir, ou se dérouler la sanglante prise d’otages des Jeux Olympiques de Munich. Quand on lui évoque aujourd’hui la sensibilité contemporaine autour de la question israélienne pour affirmer qu’un film comme Rabbi Jacob ne pourrait plus être tourné aujourd’hui, Danièle Thompson (coscénariste du film et fille du réalisateur) répond volontiers qu’à l’époque, déjà, le film semblait impossible à faire.
Evidemment, Gérard Oury et Danièle Thompson ne souhaitent pas faire un film qui décrirait ou commenterait la brûlante et tumultueuse actualité : leur propos est plus général, sans toutefois être moins politique. Selon eux, le désordre ou la violence du monde viennent souvent de la méconnaissance ou des idées arrêtées, et les tensions intercommunautaires s’apaiseraient probablement si, tout simplement, on prenait le temps de repenser l’autre. Avec une forme de conviction et de sincérité qui forcent l’admiration (nous y reviendrons), ils retournent ainsi ces considérations géopolitiques (pour le dire vite) en arguments comiques : comment mieux connaître une communauté qu’en étant obligé d’en faire partie ? Et quel meilleur moyen de montrer l’inanité des préjugés que de les placer, en quantité, dans la bouche d’un personnage parfaitement odieux ?


Méthodiquement, patiemment, et avec les pincettes réclamées par l’époque, les scénaristes structurent leur récit et parviennent à le rendre cohérent en le nourrissant de plusieurs degrés de lecture, parfois très naïfs (la réplique de Pivert demandant à Slimane et Salomon s’ils ne sont pas cousins), parfois visuels (le personnage de Pivert changeant littéralement de couleur de peau, du noir au vert) et parfois conjoncturels : face à la difficulté de trouver des comédiens issus des mêmes communautés que leurs personnages (ce qui, rétrospectivement, raconte aussi une histoire du cinéma français du début des années 70), le film se retrouve à voir Henri Guybet jouer un Juif, ou Claude Giraud ou l’Italien Renzo Montagnani des Arabes. Blanc ou pas blanc, juif ou arabe, bon ou méchant, le casting du film semble finalement lui aussi nous dire que derrière les apparences ou les appartenances communautaires, au fond, nous sommes tous les mêmes.
Le propos n’est certes pas sophistiqué, et il se trouvera forcément des esprits supérieurs pour le railler, mais force est d’admettre qu’il existe peu d’exemples, dans l’histoire de la comédie française, de comédies aussi ficelées, dans lesquelles chaque séquence, tout en fonctionnant de manière autonome, sert la perspective globale. Louis de Funès, quelques mois après la sortie du film, avouera que le film lui avait « décrassé l’âme », lui qui, un peu comme le personnage, avait au départ « de bonnes petites idées ». La force d’impact du film lui doit beaucoup, et si le caractère de son personnage a été inspiré par le père dans le show télé américain All in the Family, diffusé sur CBS à partir du début des années 70, Pivert s’inscrit parfaitement dans la lignée des personnages incarnés par le comédien depuis une dizaine d’années, alignant les défauts outranciers (pêchés au gré des films parmi la colère, l’avarice, l’orgueil… ou ici l’impatience et la xénophobie) comme les grains d’un chapelet. Plusieurs témoins, présents sur le tournage, ont salué le dévouement du comédien, notamment dans les scènes réclamant une implication physique particulière : outre les heures d’entraînement consenties en prévision de la fameuse scène de la danse, citons la séquence de l’usine de chewing-gum, qui l’aura vu tomber encore et encore dans une cuve de gruau vert.


Le gag, à l’image, est au moins aussi visuellement saisissant qu’il est drôle, et il faut tout de même mettre au crédit de Gérard Oury le soin accordé à sa direction artistique. Le cabinet dentaire rose bonbon de Mme Pivert est ainsi particulièrement réussi, et l’on goûte particulièrement ces petites astuces de décors, régulières chez Oury, qui voient par exemple les dentiers exposés claquer au gré des colères de Suzy Delair.
Quoi qu’il en soit, si jamais on renâclait encore à considérer Gérard Oury comme un auteur, il est chez lui une figure de style si systématique qu’elle opère comme une signature en même temps qu’elle l’inscrit dans une tradition bien plus ancienne du cinéma burlesque (notamment américain) : c’est le gag « véhiculaire ». De la Cadillac DeVille convertible du Corniaud dépiautée en quête du Youkounkoun au train au cœur de l’action du Cerveau ; des motards louvoyant entre les citrouilles de La Grande vadrouille à Salluste passant à travers le plancher de son carrosse dans La Folie des grandeurs ; ou de la voiture de Bourvil au début du Corniaud au vélo du même Bourvil dans La Grande vadrouille, il semblerait que le destin d’un moyen de locomotion, chez Oury, soit d’être maltraité, démonté, en tout cas extrait de sa vocation initiale pour devenir, avant tout et essentiellement, le vecteur d’un gag. Pourquoi la voiture de Pivert roule-t-elle avec un bateau sur la galerie, sinon pour annoncer la cascade qui verra le véhicule se retourner et amerrir sur un lac ? De façon symptomatique, il semble n’y avoir des bouchons avant l’aéroport que pour justifier cette image, incongrue et réjouissante, d’un troupeau de juifs hassidiques à papillotes portant à bout de bras un taxi new-yorkais.


C’est que, en dernier lieu, Les Aventures de Rabbi Jacob nous charme par la manière dont, presque malgré lui, il révèle une foi presque ingénue en le cinéma, lieu d’expression de tous les possibles… et des plus belles illusions. Le cinéma comme moyen naïf de changer les mentalités, donc, nous l’avons déjà évoqué. Le cinéma comme vecteur des aventures (voir le titre) les plus totales : de la même manière que le film veut entremêler et réunir les communautés, il entreprend de réunir à la fois l’actualité politique (on a déjà parlé de la question juive, mais le film fait une référence explicite à l’Affaire Ben Barka, encore dans tous les esprits), la comédie romantique, le récit d’aventures, celui d’espionnage, le burlesque ou la comédie communautaire, en quelque sorte de faire un film qui comblerait toutes les gourmandises cinéphages. Et puis, à l’intérieur d’un scénario certes rocambolesque mais en l’état très structuré, il y a ce recours à quelque chose de presque surnaturel, ce que l’on pourrait qualifier d’erreurs scénaristiques s’il ne s’agissait pas, en réalité, de marques de confiance accordées à un spectateur en pleine suspension d’incrédulité : le rabbin rigoriste qui prend l’avion un jour de sabbat… Pivert qui vole la vraie barbe et la vraie moustache du rabbin… et le même Pivert qui, comme par enchantement, se met à danser comme s’il avait ainsi dansé toute sa vie. Dans la réalité, à cet instant, Pivert aurait été démasqué ; à l’écran, ce moment le fait tout bonnement entrer dans la légende. Qui a dit que le cinéma était plus beau que la vie ?…