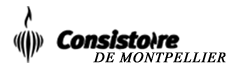Yentl
L’HISTOIRE
En 1904 en Europe Centrale (en fait, en Pologne), dans un shtetl typique des communautés juives ashkénazes, vit la jeune Yentl dont la soif d’apprentissage la différencie radicalement de ses semblables. En effet, conformément aux principes et aux lois du judaïsme, seuls les hommes ont le droit d’étudier et de commenter la Torah et les autres textes religieux. C’est donc en secret que Yentl s’instruit chez elle, avec la complicité de son vieux père généreux et compréhensif qui l’aide dans son instruction. Lorsque ce dernier vient à mourir, la jeune femme décide de quitter son village de Bechev et se grime en garçon ; elle devient Anshel afin de pouvoir suivre des études talmudiques à l’égal des hommes. Sur sa route, elle rencontre l’imposant et séduisant Avigdor qui est sur le point d’intégrer une yeshiva (un centre d’études de la Torah et des textes qui la commentent). Celui-ci se lie d’amitié avec il/elle et l’aide à intégrer l’école. Yentl s’accomplit enfin comme l’individu cultivé qu’elle a toujours souhaité être, mais elle doit constamment faire des efforts pour dissimuler sa véritable identité. La situation se complique alors qu’elle tombe amoureuse d’Avigdor et que ce dernier, dont le mariage prévu avec la belle Hadass est annulé, propose désespérément à Yentl/Anshel d’épouser son ex-fiancée afin de pouvoir continuer à la fréquenter. Le vertige existentiel atteint son point d’orgue…
ANALYSE ET CRITIQUE
Dans le monde de la création, aux confluences de plusieurs formes d’expressions artistiques, il est parfois des rencontres singulières, surprenantes, que d’aucuns jugeront même saugrenues. Quel rapport peut-il y avoir en effet entre le plus lumineux, mystique et pénétrant écrivain-poète juif du XXème siècle, à la fois légataire et animateur d’une culture, d’une langue et d’une tradition quasi révolues, et une comédienne chanteuse hollywoodienne dont la subtilité (sinon dans le chant) n’a jamais été l’une des caractéristiques premières ? Pourtant on n’ira pas jusqu’à remettre en question la légitimité de cette dernière, Barbra Streisand donc, à s’emparer d’un matériau littéraire dont elle s’est sentie proche afin d’en tirer une vision profondément intime, et ce même si son adaptation trahit quelque peu sa source (mais n’est-ce pas inévitablement la nature d’une adaptation ?).
Avec Yentl, Streisand, scénariste, réalisatrice et productrice, s’impose comme la maîtresse d’œuvre d’un projet longtemps mûri et adapte ainsi la nouvelle Yentl the Yeshiva Boy du grand Isaac Bashevis Singer, incluse dans le recueil Yentl et autres nouvelles. La comédienne juive américaine, révélée à 26 ans grâce à Funny Girl (1968) de William Wyler puis Hello Dolly ! (1969) de Gene Kelly, avait en tête de porter ce récit à l’écran dès la fin des années 60. De scénarios (dont l’un des tout premiers rédigé par Singer lui-même) en réécritures, de nombreux refus en annulations diverses, le projet connut de longs et répétés soubresauts jusqu’en 1982 quand MGM/United Artists accepta de le financer. Dès 1976, Streisand, auréolée du succès de la nouvelle version de A Star Is Born, avait pris la décision d’assurer elle-même la mise en scène d’un film qui serait aussi un musical. Et même si le fait que le rôle de Yentl soit tenu par la principale intéressée fut l’une des causes des nombreux blocages (en raison de la différence d’âge), l’actrice réalisatrice campa sur ses positions. Cela dit, avec le recul, si Streisand paraît effectivement trop âgée pour interpréter ce personnage, on imagine mal une autre actrice s’investir à ce point dans ce dernier et surtout assurer les parties chantées avec autant de puissance et de personnalité.

Le tempérament orgueilleux de Barbra Streisand a toujours posé problème au sein de Hollywood, son exigence artistique et son obsession du contrôle aussi bien au cinéma que dans le milieu musical ont indisposé de nombreuses personnes et lui ont valu beaucoup de moqueries de même qu’une bonne dose de rancœur de la part de certains. Le fait même que Yentl ait été spectaculairement boudé aux Oscars 1984 – alors que le film venait de remporter deux Golden Globes (qui sont des prix remis par la presse étrangère) est directement lié aux relations conflictuelles entre Streisand et le milieu hollywoodien. L’omniprésence de Barbra Streisand dans le projet Yentl, supposé au détriment du personnage principal et de l’arrière-plan culturel, fut l’un des reproches, nombreux et féroces, adressés publiquement par Singer. L’écrivain condamna aussi l’option musicale adoptée par la réalisatrice, ainsi que la trahison de l’esprit de sa nouvelle et notamment la nouvelle conclusion entérinée par le film.
Les invectives proférées par l’auteur de la nouvelle se comprennent aisément au regard de l’appropriation très personnelle de son matériau par la cinéaste en herbe. Isaac Bashevis Singer, né en Pologne en 1902, fils d’un rabbin hassidique, a conçu une œuvre aux frontières de la chronique sociale et du conte merveilleux qui explorait avec verve, malice et complexité le quotidien des populations juives d’Europe Centrale et de l’Est très attachées aux principes et aux modes de vie religieux durant des siècles, des communautés soudées et très enracinées dans la Mitteleuropa et les territoires polonais et russe et organisées en petits villages (les shtetls), à l’écart des autres habitants. En 1935, Singer quitte la Pologne pour les Etats-Unis, anticipant les ravages du nazisme. Il sera lauréat du prix Nobel de littérature en 1978 après avoir bâti un corpus littéraire unique entièrement en yiddish, la langue des juifs européens qu’il a fait vivre et sublimée de livres en recueils jusqu’à sa disparition en 1991. Les écrits de Singer sont remplis d’apparitions surnaturelles, de visions oniriques ; ils alternent entre humour et drame existentiel, ce sont des écrits dans lesquels priment des questionnements sur l’identité et ses troubles dissociatifs, sur la difficulté à trouver sa place dans une communauté bien ordonnée et très attachée à ses traditions religieuses.
Dans le Yentl de Barbra Streisand, tout aspect fantastique ou fabuleux est abandonné. Si le background culturel et religieux est bel et bien présent, si l’humour juif ashkénaze pointe régulièrement, la problématique de l’identité multiple et aliénante cède la place à un récit d’émancipation crypto-féministe. Streisand, qui a eu le courage et le mérite de s’imposer dans un univers d’hommes comme une réalisatrice d’une production à 15 millions de dollars, livre une bataille pour faire reconnaître à son personnage le même droit au savoir sacré que les hommes qui se sont accaparé ce privilège (supposément dicté par Dieu) dans un monde où les femmes sont cloisonnées et maintenues – même avec tendresse et respect – à leur rôle de serviteur pour leurs parents puis leur conjoint. L’aspect tragique de la nouvelle, le conflit intérieur qui oppose l’être social et l’être profond, et qui amène l’individu à duper les autres aussi bien que soi-même pour conduire à l’isolement, est quasiment évacué. La quête d’égalité, de liberté, d’amour sans contrainte l’emporte plutôt. Dans la nouvelle, Yentl, au comble de la culpabilité, quitte Avigdor après lui avoir révélé son secret et part étudier le Talmud dans une autre localité. On lui devine une existence future amère, faite de solitude et de renfermement sur sa double nature conflictuelle. Dans le film, le malaise issu des cachotteries de Yentl est comme dissipé, la jeune femme émancipée part achever sa quête de liberté en embarquant vers les Etats-Unis. La cinéaste, qui a recours à la mythologie de l’Amérique terre naturelle d’émigration et de libertés individuelles, donne l’impression de se débarrasser des oripeaux de la culture juive est-orientale pour embrasser les idéaux du Nouveau Monde. Il n’est donc pas étonnant que cette nouvelle fin soit restée en travers de la gorge d’Isaac Bashevis Singer.
Cependant, un point commun intéressant entre la nouvelle et le film est qu’aucune des deux œuvres ne condamne véritablement la discrimination dont fait preuve la religion juive à l’égard des femmes. Yentl aspire avant tout à étudier le talmud et les textes sacrés, à les commenter, à l’égal d’un homme ; mais la nature de l’enseignement lui-même n’est pas vraiment remise en question sur ce point (à noter que chez Singer, Yentl se déguisait déjà en homme avant le décès de son père). Dans la nouvelle, la jeune femme, pourtant méritante à bien des égards, est même vue comme un obstacle à l’ordre social et son destin d’errance et de solitude n’est pas vraiment enviable. Dans le film non plus, on ne trouve pas de tentative de saper les fondements de la discrimination hommes-femmes professée par les lois religieuses. Avigdor et Hadass se retrouvent finalement pour vivre leur amour sans entraves alors que Yentl s’échappe vers un avenir plein de promesses. Streisand se concentre sur une émancipation individuelle proche des aspirations du mouvement juif libéral américain, qui préfère apporter des corrections et de nouvelles interprétations aux textes religieux plutôt que de les subvertir. Mais tout bien considéré, on n’ira évidemment pas reprocher à la fois à Singer et à Streisand de ne pas avoir versé dans le brûlot antireligieux, cela n’était en aucun cas leur propos.
Enfin, on ne contestera pas le droit à Barbra Streisand de livrer une vision proche de ses préoccupations. Surtout que l’une d’entre elles concerne sa relation à un père qu’elle n’a jamais connu puisque décédé alors qu’elle était une très jeune enfant. A la fin du générique, Streisand a fait inscrire cette dédicace : « Ce film est dédié à mon père… et à tous les pères. » Yentl débute et se termine ainsi avec un message d’amour et de reconnaissance envers la figure paternelle. Les scènes entre Yentl et son père Reb Mendel – interprété par le débonnaire Nehemiah Persoff (principalement acteur de télévision) – font logiquement partie des plus émouvantes. De même, la conclusion du film aux envolées lyriques sur le bateau en vogue vers les Etats-Unis est une séquence construite pour faire vibrer le coeur des spectateurs à l’unisson avec celui de Yentl ; dans la chanson Piece of Sky, Yentl/Streisand répond au titre phare du film – Papa, Can You Hear Me ? – en chantant à son père, dont elle ressent enfin la présence indéfectible, qu’elle a obtenu les réponses à ses attentes. C’est dans ces moments que l’approche musicale choisie par Streisand montre sa pleine efficacité. La réalisatrice a fait appel au Français Michel Legrand, compositeur de génie dont l’aura aux USA est presque aussi considérable que dans l’Hexagone (grâce entre autres à L’Affaire Thomas Crown, Un été 42, Breezy, Les Trois Mousquetaires, Atlantic City, Jamais plus jamais). On n’ira pas jusqu’à affirmer que Legrand a produit ici l’une de ses bandes originales les plus notables mais certains thèmes, comme les chansons citées ci-dessus ou encore Will Someone Ever Look at Me That Way ? et The Way He Makes Me Feel, sont particulièrement agréables à l’écoute. Mais l’utilisation de la musique dans Yentl a ceci de particulier qu’elle hésite constamment entre la prestation scénique classique d’une comédie musicale – au cours de laquelle le personnage s’extraie de la narration pour commenter l’action – et le monologue intérieur de Yentl/Anshel (que viennent interrompre parfois les discussions d’autres personnages). L’effet est parfois intriguant, parfois irritant, et la mise en scène peine souvent à sublimer ces moments.
Cela dit, on ne fera pas grief à Barbra Streisand de ne pas s’investir pleinement dans sa réalisation, même si l’on n’assiste certes pas ici à la naissance d’une grande cinéaste. Le savoir-faire est certain, l’inspiration quelquefois bien réelle, l’apprentissage auprès des réalisateurs croisés au cours de sa carrière manifeste (Wyler, Minnelli, Pollack), mais rarement Yentl décolle afin d’atteindre les sommets attendus pour un sujet qui traite de l’élévation des âmes. Le film compte même parfois quelques fautes de goût comme la présentation du shtetl de Bechev qui semble issue d’un joli chromo estampillé Disney. Ce qui cadre avec l’absence de sexe, présent crûment dans la nouvelle de Singer, si ce n’est sous la forme de petites touches humoristiques. Pourtant, quelques idées de mise en scène méritent d’être relevées comme, grâce à un raccord de montage, la correspondance visuelle entre Yentl derrière la boiserie de l’étage réservé aux femmes dans la synagogue et les barreaux d’une cage aux poules. Plus généralement, on observe de belles compositions de cadre, notamment dans les intérieurs, dont l’attrait repose aussi et surtout – il faut bien le reconnaître – sur la photographie chaleureuse et mordorée de David Watkin (La Charge de la brigade légère, Les Diables, La Rose et la flèche, Guerre et passion, Les Chariots de feu, Out of Africa). Le romantisme – au sens large -, la nostalgie d’une époque disparue et les rares moments de spiritualité convoqués par Streisand doivent beaucoup aux effets lumineux tout en nuances mis en place par Watkin. Un autre contributeur important se nomme Terry Rawlings (La Sentinelle des maudits, Alien, Les Chariots de feu, Blade Runner, Legend), dont le travail de montage associé au découpage de la réalisatrice confère à plusieurs séquences un souffle et même une originalité bienvenus (comme la scène chez le tailleur ou la fin sur le bateau).
Une autre qualité du film provient de l’interprétation. A part la douce Amy Irving qui semble un peu perdue dans son personnage (sauf dans ses dernières scènes), le casting fait part d’une belle homogénéité. Surtout, la relation difficile – car reposant sans cesse sur des sous-entendus – entre Yentl et Avigdor offre des instants d’une belle complicité, voire d’une grande délicatesse. On les doit beaucoup au talent de Mandy Patinkin (Ragtime, Daniel), alors âgé de 31 ans, que les téléspectateurs des années 2010 connaissent aujourd’hui sous les traits de Saul Berenson, agent en chef de la CIA dans l’impressionnante série Homeland. Dynamique, frais, charmant, emporté et un peu maladroit, son Avigdor ne laisse pas indifférent et l’acteur « bouffe » l’écran à chacune de ses apparitions. A ses côtés, Barbra Streisand ne démérite pas dans le rôle titre. Souvent objet de quolibets, l’actrice tient pourtant le film sur ses épaules et réussit le plus souvent à ne pas tirer la couverture à elle comme elle eut maintes fois l’occasion de le faire par le passé. Son interprétation comme chanteuse est bien évidemment sans commune mesure avec ses talents corrects d’actrice : quand sa voix sublime s’élève, à la fois puissante, profonde, riche de nuances et d’harmonies, les séquences prennent une toute autre ampleur. On regrettera simplement la triste banalité des paroles de la plupart des titres, qui versent dans une redondance incroyable pour une telle production, se contentant de doublonner paresseusement ce que l’image et les comédiens nous racontent, sans prendre la peine d’offrir un contrepoint ou d’anticiper sur la narration.
En conclusion, si les allergiques à Barbra Streisand et les rétifs aux adaptations hollywoodiennes ne sachant pas toujours éviter le miel et les facilités ne donneront certainement pas une nouvelle chance à Yentl près de trente-cinq ans après sa sortie, d’autres cinéphiles pourront manifester de la curiosité pour une œuvre restée attachante par bien des aspects malgré ses nombreux défauts. De plus, à une époque où le combat féministe a pris une nouvelle ampleur, secoue les consciences et se cherche des figures de proue, il est fort probable que de nombreux spectateurs ne resteront pas insensibles au charme de l’opiniâtre et combattive Yentl.